Quatre-vingt-dix ans après la traduction de « Sanctuaire », qui révéla Faulkner en France, Romain Artiguebère nous livre une analyse de l’écrivain, romancier de la trace, de la sensation et surtout de l’héritage. Sise dans la terre fendue – et surtout fictive – du comté de Yaknapatawpha, cette œuvre magistrale a dépassé l’indécente assignation à résidence que certains cherchèrent à lui appliquer, renvoyant ce bout d’Universel à une Littérature locale bien éloignée de sa nature première. A travers Faulkner, une part de l’Homme se révèle, dans sa misère d’héritier, son épaisseur tragique de mémoire vive, de bois vivant et perpétué, toujours mu par la sève originelle ».
« Je n’écris pas pour dire ce que je pense, mais pour le savoir ». Sans doute est-ce mon courant de conscience qui me conduit à associer cette phrase d’Emmanuel Berl à l’œuvre de Faulkner, à son acte d’écrire le Sud meurtri d’une Guerre sans âge, celle de la Sécession, terrible trace qui ne disparaît pas, comme l’atavisme des Compson, des Sartoris ardents et des Snopes traînants, la honte active, tenace et lasse d’une terre qui ne ment pas, la résilience d’un feu sans armistice.
 Ecrire dans la moiteur des fiefs de Lee, donner à voir ce Mississippi où l’on lynche à l’appel d’un slogan, où l’on remet le destin de comtés centenaires aux Vardam et Bilbo, ces potentats locaux qui tinrent sous leur férule confédérée, sous le joug démocrate au discours enfiévré, le destin d’une Amérique arrachée de ses fondations et privée pendant quatre ans de ses mamelles philadelphiennes. Comprendre les lignées bouleversées par l’angoisse de n’être plus qu’un nom effacé par le Temps. Tels sont sans doute les sensations et les effets que l’œuvre faulknérienne procure au lecteur, une œuvre dont le style est à lui seul un paradoxe extraordinaire, comme la transcription naturelle d’une oralité, d’un « chant » populaire si bien travaillé qu’il est devenu la prose des Hommes défaits.
Ecrire dans la moiteur des fiefs de Lee, donner à voir ce Mississippi où l’on lynche à l’appel d’un slogan, où l’on remet le destin de comtés centenaires aux Vardam et Bilbo, ces potentats locaux qui tinrent sous leur férule confédérée, sous le joug démocrate au discours enfiévré, le destin d’une Amérique arrachée de ses fondations et privée pendant quatre ans de ses mamelles philadelphiennes. Comprendre les lignées bouleversées par l’angoisse de n’être plus qu’un nom effacé par le Temps. Tels sont sans doute les sensations et les effets que l’œuvre faulknérienne procure au lecteur, une œuvre dont le style est à lui seul un paradoxe extraordinaire, comme la transcription naturelle d’une oralité, d’un « chant » populaire si bien travaillé qu’il est devenu la prose des Hommes défaits.
Faulkner fut un brûleur, cavalier frénétique, aviateur tumultueux, ivrogne invétéré dans cet « Etat du Magnolia » où coulent toujours Bourbon, liqueurs chaudes comme le Sang et bien sûr Salsepareille. C’était aussi un Homme discret, un de ces génies calmes habités d’un bon sens qui diminue parfois mais qui chez lui nourrit une œuvre à l’abondance fluviale, coulant dans Jefferson, aux pieds des caroubiers de Yaknapatawpha. Une œuvre complexe au Style alambiqué, entremêlé parfois comme les affres intérieures de l’héritier. Une œuvre épaisse, ardue, exigeante et prolixe. Un corpus épatant qui valut à la plume de Lafayette – pardon pour ces surnoms qu’il vouait aux gémonies de la vulgarité – l’obtention d’un Nobel en 1950, après un an de rumeurs folles, dans le fatras lassant des hésitations de jurés qui souhaitèrent le lui attribuer en 1949.
Cette œuvre est celle de la marque et du stigmate, celle de la trace qui ne part pas, de la souillure et des lignées dont ne se départit vraiment jamais. Elle est aussi celle des patronymes, des allégeances à la Pensée commune d’un terroir qu’on ne quitte pas plus que la relève d’une communauté, la horde des « Junior », n’abandonnerait un nom sans lequel on ne peut être.
La famille Sartoris forge une grande part de l’œuvre générale. Elle est un patronyme récurrent, courroie de transmission du message faulknérien. C’est une lignée battue par les vents du chaos et dont tous les membres sont frappés de morts prématurées. Comme les Rougon, Macquart, Thibault ou Buddenbrook, elle garnit les tombereaux d’anthroponymes élevés en archétypes, de noms que l’on dit propres et qui marquent un espace, épaississent un écrit grâce à eux élevé en référence. Dans L’Invaincu, roman de formation qui détermine cette lignée des Sartoris, Bayard instille, dans sa propre famille, la faute et le péché en désirant l’interdit au cœur de la Guerre, c’est-à-dire la propre femme de son père. Ainsi retrouve-t-on là un peu de cette charge honteuse qui fit le sel de Radiguet dans son Diable au corps, l’intrusion d’un front immatériel dans « l’arrière » protégé des combats. Car l’attirance incestueuse du jeune Bayard pour Drusilla ne révèle pas seulement la matrice du Faulknérisme, elle est la personnalisation d’un tabou, l’exposition d’un mal si puissant d’être tu.
Un génie qui s’ignora toujours
Il semble que Faulkner n’ait pas vraiment compris l’origine de sa destinée. Sans doute est-ce là le succulent paradoxe du romancier de l’indice et de l’hérédité, capteur du trait qui détermine, du geste qui confond, de toutes les extensions du domaine de l’anatomie, sculpteur d’identités, de clans gorgés de souvenirs familiaux, d’une Mémoire de comtés.
Pour son biographe Frederick R. Karl, Faulkner « contredit presque systématiquement ce dont il s’est nourri », une assertion qui nous éclaire lorsqu’on songe aux rapports que l’auteur entretenait avec le Sud. Il est difficile d’établir la nature d’un lien qui, de toute manière, harnache et détermine comme un nom, porté avec la fierté nécessaire que la circonstance mue en charge patronymique. Ce Sud, Faulkner le révère-t-il ou le stigmatise-t-il ? La même ambivalence nous enserre dès lors qu’on s’interroge sur la question raciale. Et ce fut à l’occasion d’une rencontre avec l’écrivain Mohammed Mbougar Sarr, formidable « globetrotteur » littéraire « si souvent passé par l’Amérique et les vieilles terres confédérées », qu’a jailli devant mois l’Institution faulknérienne, la statue de Légende que le Goncourt 2021 qualifia « d’essentielle », c’est-à-dire de recours dans ce qui constitue, à certains égards, le grand mensonge du monde étasunien.
Et c’est sans doute ce goût du Vrai, la révélation d’une Gloire déchue maintenue par la réminiscence, qui constitue le nœud gordien du roman faulknérien. Car, comme le soulignait à raison Heidegger, « l’art est un advenir de la vérité ». Et c’est précisément devant cet art que l’auteur s’est effacé, comme un père éclipsé par son fils continuateur de la lignée. Il l’a fait intégralement, c’est-à-dire jusque dans son épitaphe, choisie par lui avec une insolence de trompe-la-mort, une assurance qui dit beaucoup de la grandeur morale du personnage : « il fit des livres et il mourut ». L’éternel et la postérité n’ont qu’à bien se tenir. Et il n’est pas nécessaire de s’intéresser à l’Histoire de l’Amérique pour apprécier un « style » certes parfois tortueux mais toujours poussé par le souvenir de la fierté passée, un souvenir tenace et résolu de l’extrême Sud étasunien par trop conscient de son déclin. Le comté fictif de Faulkner est en effet comme ces fauves blessés qui bougent encore, l’animal tiraillé par l’abandon et le sursaut, rugissant dans son baroud d’honneur, le résidu actif et las, capitulard et résistant, d’un monde éternel et pourtant finissant, celui des petits Blancs du Sud profond qui ne cesse pas d’expirer.
A Yaknapatawpha sommeille la Vérité fragile des lignées confédérées, où chaque mort est une étape de plus vers l’amoindrissement du Souvenir, fardeau libérateur qui choit à moins qu’on ne l’exerce.
Lire la suite
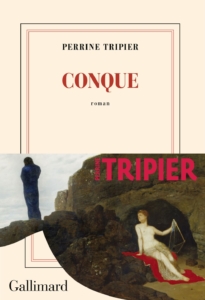 « CONQUE : nom féminin, coquille en spirale servant d’instrument depuis des millénaires. Coquillage berceau et tombeau, où se niche, caché, le grain de sable. »
« CONQUE : nom féminin, coquille en spirale servant d’instrument depuis des millénaires. Coquillage berceau et tombeau, où se niche, caché, le grain de sable. »
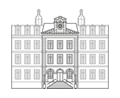
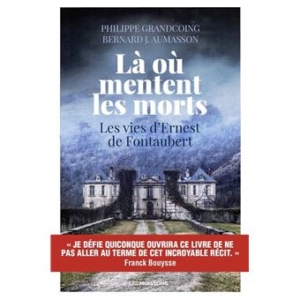 Décembre 1913, Montcigoux, est un lieu oublié au milieu de la France. Des ouvriers mettent au jour un squelette dans les dépendances du château. Il s’agirait d’Ernest de Fontaubert, l’ancien propriétaire des lieux, parti en 1850 faire fortune en Californie et mystérieusement disparu depuis.
Décembre 1913, Montcigoux, est un lieu oublié au milieu de la France. Des ouvriers mettent au jour un squelette dans les dépendances du château. Il s’agirait d’Ernest de Fontaubert, l’ancien propriétaire des lieux, parti en 1850 faire fortune en Californie et mystérieusement disparu depuis.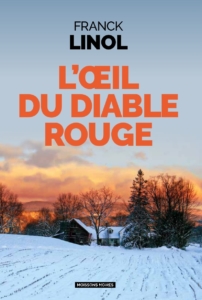 Une nouvelle enquête de Dumontel où l’on retrouve tous les personnages qui traversent la fameuse série policière dite de “l’Inspecteur Dumontel”.
Une nouvelle enquête de Dumontel où l’on retrouve tous les personnages qui traversent la fameuse série policière dite de “l’Inspecteur Dumontel”.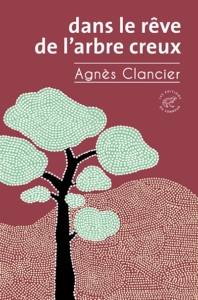 Janvier 1791. Une jeune Anglaise s’évade de la colonie pénitentiaire de Sydney, aux confins de l’Australie. Perdue dans l’immensité du bush, au cœur d’un pays inexploré, elle prend rapidement conscience qu’il lui sera impossible de survivre seule. Boire, manger, dormir : rien ne se donne, tout est à conquérir. Jusqu’à sa rencontre avec une tribu aborigène…
Janvier 1791. Une jeune Anglaise s’évade de la colonie pénitentiaire de Sydney, aux confins de l’Australie. Perdue dans l’immensité du bush, au cœur d’un pays inexploré, elle prend rapidement conscience qu’il lui sera impossible de survivre seule. Boire, manger, dormir : rien ne se donne, tout est à conquérir. Jusqu’à sa rencontre avec une tribu aborigène… Agnès Clancier a publié une dizaine de livres, dont Le Pèlerin de Manhattan (Climats, 2003), Port Jackson (Gallimard, coll. Blanche), roman qui relate l’installation des Européens en Australie à la fin du XVIIIe siècle, et
Agnès Clancier a publié une dizaine de livres, dont Le Pèlerin de Manhattan (Climats, 2003), Port Jackson (Gallimard, coll. Blanche), roman qui relate l’installation des Européens en Australie à la fin du XVIIIe siècle, et 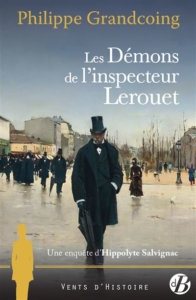 Mais qui a bien pu assassiner la femme de Jules Lerouet, réveillant tous ses démons ?
Mais qui a bien pu assassiner la femme de Jules Lerouet, réveillant tous ses démons ? Historien spécialiste des XIXe et XXe siècles, Philippe Grandcoing a publié de nombreux ouvrages, notamment huit volumes de la collection des « Grandes affaires criminelles » aux éditions De Borée, ainsi que la célèbre série d’enquêtes historiques de l’antiquaire Hippolyte Salvignac ; « Les démons de l’inspecteur Lerouet » en est le 7e opus. Notez que «
Historien spécialiste des XIXe et XXe siècles, Philippe Grandcoing a publié de nombreux ouvrages, notamment huit volumes de la collection des « Grandes affaires criminelles » aux éditions De Borée, ainsi que la célèbre série d’enquêtes historiques de l’antiquaire Hippolyte Salvignac ; « Les démons de l’inspecteur Lerouet » en est le 7e opus. Notez que « 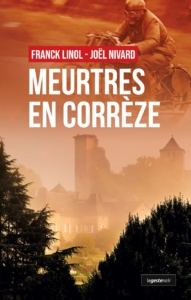 Le troisième opus écrit à quatre mains par le tandem Linol/Nivard, polar qui mêle humour, suspens, personnages attachants et qui nous replonge dans les années sombres de l’occupation allemande.
Le troisième opus écrit à quatre mains par le tandem Linol/Nivard, polar qui mêle humour, suspens, personnages attachants et qui nous replonge dans les années sombres de l’occupation allemande.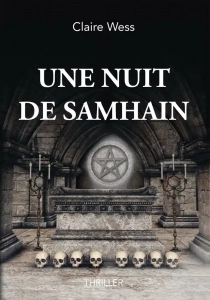 2019. Après 20 ans d’absence, Tristane, jeune médecin et descendante Wiccane, retrouve Le Dorat, village de son enfance. Quand elle emménage dans la maison de sa grand-mère décédée, avec qui elle est toujours en contact à travers ses rêves, les menaces à son encontre et les meurtres dont elle pourrait être victime s’accumulent.
2019. Après 20 ans d’absence, Tristane, jeune médecin et descendante Wiccane, retrouve Le Dorat, village de son enfance. Quand elle emménage dans la maison de sa grand-mère décédée, avec qui elle est toujours en contact à travers ses rêves, les menaces à son encontre et les meurtres dont elle pourrait être victime s’accumulent. Claire Wess vit en Haute-Vienne depuis 2011.
Claire Wess vit en Haute-Vienne depuis 2011.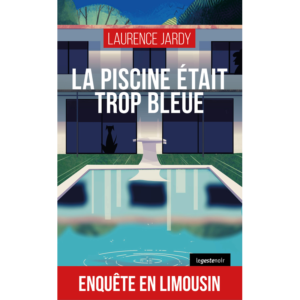 Le mot de l’éditeur
Le mot de l’éditeur Laurence Jardy est née à Aubusson le 12 décembre 1966. Elle a poursuivi une partie de ses études au lycée Gay-Lussac de Limoges. Elle vit aujourd’hui à Saint-Léonard-de-Noblat.
Laurence Jardy est née à Aubusson le 12 décembre 1966. Elle a poursuivi une partie de ses études au lycée Gay-Lussac de Limoges. Elle vit aujourd’hui à Saint-Léonard-de-Noblat.
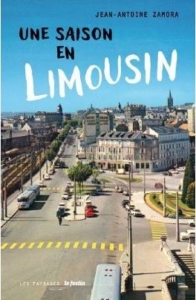 Un roman et une investigation : un livre-double, deux faces indissociables qui dialoguent entre elles.
Un roman et une investigation : un livre-double, deux faces indissociables qui dialoguent entre elles. Ecrire dans la moiteur des fiefs de Lee, donner à voir ce Mississippi où l’on lynche à l’appel d’un slogan, où l’on remet le destin de comtés centenaires aux Vardam et Bilbo, ces potentats locaux qui tinrent sous leur férule confédérée, sous le joug démocrate au discours enfiévré, le destin d’une Amérique arrachée de ses fondations et privée pendant quatre ans de ses mamelles philadelphiennes. Comprendre les lignées bouleversées par l’angoisse de n’être plus qu’un nom effacé par le Temps. Tels sont sans doute les sensations et les effets que l’œuvre faulknérienne procure au lecteur, une œuvre dont le style est à lui seul un paradoxe extraordinaire, comme la transcription naturelle d’une oralité, d’un « chant » populaire si bien travaillé qu’il est devenu la prose des Hommes défaits.
Ecrire dans la moiteur des fiefs de Lee, donner à voir ce Mississippi où l’on lynche à l’appel d’un slogan, où l’on remet le destin de comtés centenaires aux Vardam et Bilbo, ces potentats locaux qui tinrent sous leur férule confédérée, sous le joug démocrate au discours enfiévré, le destin d’une Amérique arrachée de ses fondations et privée pendant quatre ans de ses mamelles philadelphiennes. Comprendre les lignées bouleversées par l’angoisse de n’être plus qu’un nom effacé par le Temps. Tels sont sans doute les sensations et les effets que l’œuvre faulknérienne procure au lecteur, une œuvre dont le style est à lui seul un paradoxe extraordinaire, comme la transcription naturelle d’une oralité, d’un « chant » populaire si bien travaillé qu’il est devenu la prose des Hommes défaits.

