Quatre-vingt-dix ans après la traduction de « Sanctuaire », qui révéla Faulkner en France, Romain Artiguebère nous livre une analyse de l’écrivain, romancier de la trace, de la sensation et surtout de l’héritage. Sise dans la terre fendue – et surtout fictive – du comté de Yaknapatawpha, cette œuvre magistrale a dépassé l’indécente assignation à résidence que certains cherchèrent à lui appliquer, renvoyant ce bout d’Universel à une Littérature locale bien éloignée de sa nature première. A travers Faulkner, une part de l’Homme se révèle, dans sa misère d’héritier, son épaisseur tragique de mémoire vive, de bois vivant et perpétué, toujours mu par la sève originelle ».
« Je n’écris pas pour dire ce que je pense, mais pour le savoir ». Sans doute est-ce mon courant de conscience qui me conduit à associer cette phrase d’Emmanuel Berl à l’œuvre de Faulkner, à son acte d’écrire le Sud meurtri d’une Guerre sans âge, celle de la Sécession, terrible trace qui ne disparaît pas, comme l’atavisme des Compson, des Sartoris ardents et des Snopes traînants, la honte active, tenace et lasse d’une terre qui ne ment pas, la résilience d’un feu sans armistice.
 Ecrire dans la moiteur des fiefs de Lee, donner à voir ce Mississippi où l’on lynche à l’appel d’un slogan, où l’on remet le destin de comtés centenaires aux Vardam et Bilbo, ces potentats locaux qui tinrent sous leur férule confédérée, sous le joug démocrate au discours enfiévré, le destin d’une Amérique arrachée de ses fondations et privée pendant quatre ans de ses mamelles philadelphiennes. Comprendre les lignées bouleversées par l’angoisse de n’être plus qu’un nom effacé par le Temps. Tels sont sans doute les sensations et les effets que l’œuvre faulknérienne procure au lecteur, une œuvre dont le style est à lui seul un paradoxe extraordinaire, comme la transcription naturelle d’une oralité, d’un « chant » populaire si bien travaillé qu’il est devenu la prose des Hommes défaits.
Ecrire dans la moiteur des fiefs de Lee, donner à voir ce Mississippi où l’on lynche à l’appel d’un slogan, où l’on remet le destin de comtés centenaires aux Vardam et Bilbo, ces potentats locaux qui tinrent sous leur férule confédérée, sous le joug démocrate au discours enfiévré, le destin d’une Amérique arrachée de ses fondations et privée pendant quatre ans de ses mamelles philadelphiennes. Comprendre les lignées bouleversées par l’angoisse de n’être plus qu’un nom effacé par le Temps. Tels sont sans doute les sensations et les effets que l’œuvre faulknérienne procure au lecteur, une œuvre dont le style est à lui seul un paradoxe extraordinaire, comme la transcription naturelle d’une oralité, d’un « chant » populaire si bien travaillé qu’il est devenu la prose des Hommes défaits.
Faulkner fut un brûleur, cavalier frénétique, aviateur tumultueux, ivrogne invétéré dans cet « Etat du Magnolia » où coulent toujours Bourbon, liqueurs chaudes comme le Sang et bien sûr Salsepareille. C’était aussi un Homme discret, un de ces génies calmes habités d’un bon sens qui diminue parfois mais qui chez lui nourrit une œuvre à l’abondance fluviale, coulant dans Jefferson, aux pieds des caroubiers de Yaknapatawpha. Une œuvre complexe au Style alambiqué, entremêlé parfois comme les affres intérieures de l’héritier. Une œuvre épaisse, ardue, exigeante et prolixe. Un corpus épatant qui valut à la plume de Lafayette – pardon pour ces surnoms qu’il vouait aux gémonies de la vulgarité – l’obtention d’un Nobel en 1950, après un an de rumeurs folles, dans le fatras lassant des hésitations de jurés qui souhaitèrent le lui attribuer en 1949.
Cette œuvre est celle de la marque et du stigmate, celle de la trace qui ne part pas, de la souillure et des lignées dont ne se départit vraiment jamais. Elle est aussi celle des patronymes, des allégeances à la Pensée commune d’un terroir qu’on ne quitte pas plus que la relève d’une communauté, la horde des « Junior », n’abandonnerait un nom sans lequel on ne peut être.
La famille Sartoris forge une grande part de l’œuvre générale. Elle est un patronyme récurrent, courroie de transmission du message faulknérien. C’est une lignée battue par les vents du chaos et dont tous les membres sont frappés de morts prématurées. Comme les Rougon, Macquart, Thibault ou Buddenbrook, elle garnit les tombereaux d’anthroponymes élevés en archétypes, de noms que l’on dit propres et qui marquent un espace, épaississent un écrit grâce à eux élevé en référence. Dans L’Invaincu, roman de formation qui détermine cette lignée des Sartoris, Bayard instille, dans sa propre famille, la faute et le péché en désirant l’interdit au cœur de la Guerre, c’est-à-dire la propre femme de son père. Ainsi retrouve-t-on là un peu de cette charge honteuse qui fit le sel de Radiguet dans son Diable au corps, l’intrusion d’un front immatériel dans « l’arrière » protégé des combats. Car l’attirance incestueuse du jeune Bayard pour Drusilla ne révèle pas seulement la matrice du Faulknérisme, elle est la personnalisation d’un tabou, l’exposition d’un mal si puissant d’être tu.
Un génie qui s’ignora toujours
Il semble que Faulkner n’ait pas vraiment compris l’origine de sa destinée. Sans doute est-ce là le succulent paradoxe du romancier de l’indice et de l’hérédité, capteur du trait qui détermine, du geste qui confond, de toutes les extensions du domaine de l’anatomie, sculpteur d’identités, de clans gorgés de souvenirs familiaux, d’une Mémoire de comtés.
Pour son biographe Frederick R. Karl, Faulkner « contredit presque systématiquement ce dont il s’est nourri », une assertion qui nous éclaire lorsqu’on songe aux rapports que l’auteur entretenait avec le Sud. Il est difficile d’établir la nature d’un lien qui, de toute manière, harnache et détermine comme un nom, porté avec la fierté nécessaire que la circonstance mue en charge patronymique. Ce Sud, Faulkner le révère-t-il ou le stigmatise-t-il ? La même ambivalence nous enserre dès lors qu’on s’interroge sur la question raciale. Et ce fut à l’occasion d’une rencontre avec l’écrivain Mohammed Mbougar Sarr, formidable « globetrotteur » littéraire « si souvent passé par l’Amérique et les vieilles terres confédérées », qu’a jailli devant mois l’Institution faulknérienne, la statue de Légende que le Goncourt 2021 qualifia « d’essentielle », c’est-à-dire de recours dans ce qui constitue, à certains égards, le grand mensonge du monde étasunien.
Et c’est sans doute ce goût du Vrai, la révélation d’une Gloire déchue maintenue par la réminiscence, qui constitue le nœud gordien du roman faulknérien. Car, comme le soulignait à raison Heidegger, « l’art est un advenir de la vérité ». Et c’est précisément devant cet art que l’auteur s’est effacé, comme un père éclipsé par son fils continuateur de la lignée. Il l’a fait intégralement, c’est-à-dire jusque dans son épitaphe, choisie par lui avec une insolence de trompe-la-mort, une assurance qui dit beaucoup de la grandeur morale du personnage : « il fit des livres et il mourut ». L’éternel et la postérité n’ont qu’à bien se tenir. Et il n’est pas nécessaire de s’intéresser à l’Histoire de l’Amérique pour apprécier un « style » certes parfois tortueux mais toujours poussé par le souvenir de la fierté passée, un souvenir tenace et résolu de l’extrême Sud étasunien par trop conscient de son déclin. Le comté fictif de Faulkner est en effet comme ces fauves blessés qui bougent encore, l’animal tiraillé par l’abandon et le sursaut, rugissant dans son baroud d’honneur, le résidu actif et las, capitulard et résistant, d’un monde éternel et pourtant finissant, celui des petits Blancs du Sud profond qui ne cesse pas d’expirer.
A Yaknapatawpha sommeille la Vérité fragile des lignées confédérées, où chaque mort est une étape de plus vers l’amoindrissement du Souvenir, fardeau libérateur qui choit à moins qu’on ne l’exerce.
Et la terre poussiéreuse du roman faulknérien, cause et but du Nobel retourné parmi les siens après un bref aller sur le Vieux Continent, porte précisément cette Vérité que Victor Hugo estimait satisfaite et honorée par les « écrivains supérieurs de l’époque », une Vérité seule à même de « ramener à tous les grands principes d’ordre, de morale et d’honneur ». Car en elle tient et croît la raison même d’une Vie. Pour l’auteur des Contemplations, le poète est porteur d’un devoir dans l’espace et le temps. Il doit être prophète et « marcher devant les peuples comme une lumière lui montrant le chemin », mais plus encore « se rappeler toujours ce que ses prédécesseurs ont trop oublié », c’est-à-dire que « lui aussi a une religion et une patrie ». Ainsi ses « chants célèbrent-ils sans cesse les gloires et infortunes de son pays […] afin que ses contemporains recueillent quelque chose de son génie et de son âme ». L’on croirait cette Loi écrite pour Faulkner tant il a brillamment relevé le gant des exigences de la Mémoire, transmise par la prose comme les fiertés héréditaires se perpétuaient jadis par la tenace oralité du Sud évaporé.
Un dentelier des mots maintenu dans l’ombres de son savoir-faire
 Comme le note Shelby Foote, auteur et historien américain, Faulkner a longtemps mis en avant une simplicité, voire une automaticité qui ne correspondait pas à son goût pourtant poussé de l’élaboration, de retravail et du soin des phrases. Il n’est que de le lire assidûment pour sentir le caractère dentelé de sa prose difficile. Pour Foote, Faulkner est parvenu à « décrire des sensations, la texture des choses, qu’il s’agisse d’une surface ou du réveil d’une aube dans les bois ». Ainsi Le Bruit et la Fureur regorge-t-il de références aux senteurs capiteuses qui se greffent aux membres d’une famille pour devenir un souvenir olfactif. Caddy, dont nous savons qu’elle parvient à « sentir la maladie » comme un chien au flair abouti, perçoit aussi les « arbres » et l’odeur de la « pluie ».
Comme le note Shelby Foote, auteur et historien américain, Faulkner a longtemps mis en avant une simplicité, voire une automaticité qui ne correspondait pas à son goût pourtant poussé de l’élaboration, de retravail et du soin des phrases. Il n’est que de le lire assidûment pour sentir le caractère dentelé de sa prose difficile. Pour Foote, Faulkner est parvenu à « décrire des sensations, la texture des choses, qu’il s’agisse d’une surface ou du réveil d’une aube dans les bois ». Ainsi Le Bruit et la Fureur regorge-t-il de références aux senteurs capiteuses qui se greffent aux membres d’une famille pour devenir un souvenir olfactif. Caddy, dont nous savons qu’elle parvient à « sentir la maladie » comme un chien au flair abouti, perçoit aussi les « arbres » et l’odeur de la « pluie ».
Malgré son attention aux choses, à cette batterie de « petits riens » qui font un Grand auteur, c’est la condition d’écrivain, à cet égard pleinement représentative de la précarité humaine, que Faulkner est parvenu à divulguer à travers ses œuvres : un cœur en conflit avec lui-même, cet organe torturé sans lequel on ne fait guère une belle prose. Car, disait Faulkner, « il n’y a que cela qui mérite d’être écrit, qui mérite toute cette douleur et toute cette sueur ». Et les mots, ainsi que l’exprime Fairchild dans Moustiques, de subir la plus belle définition, eux qui « n’ont certes pas une valeur propre mais qui, habilement combinés, produisent quelque chose qui vit ».
Aux lecteurs qui seraient tentés d’aborder la terra incognita de Yaknapatawpha, je conseille de retenir la position de Malraux, pour qui l’âme du Mississippi ne « laisse jamais rien au hasard » – assertion confirmée par l’auteur lui-même, qui révèle à propos de Tandis que j’agonise avoir « pris cette famille et lui avoir fait subir les deux plus grandes catastrophes que l’homme puisse subir… l’inondation et l’incendie ». Ainsi nous montre-t-il toujours l’Homme aux prises avec son élément.
Faulkner, guide des égarés à Yaknapatawpha
A la question de savoir par quel roman il convenait d’aborder son œuvre, William Faulkner a répondu Sartoris, publié en 1929 et perçu comme le réceptacle de ses thèmes, le Panthéon d’une tendance, ouvert à la démonstration de la déliquescence atavique, de l’indélébilité du nom meurtri par la souillure d’Appomattox. Car les Bayard et John, pris dans la tourbe des conflits armés, sont les figure archétypales des vaincus de l’Histoire pleins d’une Mémoire honteuse, coupable et douloureuse.
Mais la trilogie des Snopes, qui enjambe le Nobel, est elle aussi un pilier de l’œuvre faulknérienne en tant qu’elle met en scène l’incrustation d’un parasite, cynique et destructeur comme l’abbé Faujas du Plassans de Zola.
En arrière-fond, les êtres mineurs épaississent le roman, alourdissent l’ambiance de mouvements structurants. Colporteur de récits populaires et conteur écouté, Ratcliff est ainsi l’archétype de ces « chimères » humaines qui font tenir une armature lettrée, un de ces personnages que l’on dit secondaires et qui deviennent pourtant, par le truchement formidable du « bruit de fond », la charpente orale des fictions, l’âme d’un roman, les fixateurs d’ambiance élevés par le récit qu’ils font d’un lieu ou d’une époque. Ainsi le vendeur de machines à coudre est-il comme le fil rouge du Sud profond que l’on vient aussi chercher à travers Faulkner.
Le Bruit et la Fureur, un apax romanesque au prodige bouleversant, consécration dans une lignée fictionnelle édifiante
Il me fallait faire un sort à quelques œuvres pour partager avec plus de véracité ce qui constitue vraiment la singularité de cette plume. Car Faulkner est un écrivain de l’épreuve sans cesse imposée à lui-même. Ainsi a-t-il conçu Le Bruit et la Fureur, qui demeure sans doute le plus prestigieux de ses romans. Initialement conçu comme une nouvelle, ce récit d’un enterrement dont une fratrie est tenue exclue a été augmenté, pour ne pas dire corsé par l’écrivain lui-même, qui a fait naître « Benjy », malade mental dans lequel chaque lecteur est plongé malgré lui car enserré dans les flots tortueux d’une pensée idiote offerte à l’omniscience narrative. Mais Faulkner s’est aussi transformé au contact des siens, c’est-à-dire de l’idée devenue chair, comme le créateur se soumet à la perfection de son artefact. C’est dans cette veine qu’il a lui-même confié s’être épris de « Caddy », à laquelle un canevas sans doute hâtif ne promettait pas la dimension qu’elle prend dans l’œuvre aboutie. Le titre-même, né du subconscient de l’auteur, révèle cette filiation géniale de l’Homme du Sud-américain avec le grand Shakespeare. Car dans Macbeth déjà sommeillait l’idée de la bêtise pionnière. A la scène V de l’acte V, la vie est ainsi définie comme un « conte narré par un idiot ». Comme souvent avec Faulkner, le livre est le récit d’une prospérité familiale oxydée, d’une gloire battue par le Temps, le déchirement continuel de trois générations qui s’opposent et s’entremêlent. Là encore, et peut-être plus que dans les autres romans du Sudiste, la peur d’une salissure, l’angoisse de l’altération patronymique tient l’œuvre et la révèle, une prouesse d’autant plus remarquée qu’elle expose une prose moquée pour son caractère prétendument décousu.
C’est que Faulkner nous immerge dans l’Homme, une bête sociale prise dans son acception intégrale, celle d’un animal qui hérite, reproduit, flaire et transmet souvent malgré lui.
Dans ces liens ataviques au parfum de malaise le transport incestueux – et non concrétisé – de Quentin pour sa sœur conduit au drame, interrogeant l’interdit absolu, commun à toute l’Humanité et qui terrasse l’équilibre des Compson. Bien sûr le « nom » comme étiquette, stigmate et preuve du déshonneur occupe-t-il une place prépondérante, Benjamin étant rebaptisé « Benjy » pour prémunir son oncle Maury d’une dégradation orale et scripturaire.
Lire Faulkner, c’est donc accepter d’entrer dans les affres trompeuses de ses monologues intérieurs, se perdre pendant des heures de lectures ardues pour espérer jouir d’une illumination finale, parousie du sens au terme de l’occultation. Comme l’a si bien exprimé Malraux, Faulkner est surtout le témoin de l’irrémédiable. Héritage, Histoire, Passé, Race, Vertu ou souvent Vice. Tout vient, se greffe, accepte une mue fragile et pourtant se maintient.
Une lecture inattentive, par trop contemporaine et donc inaboutie pourrait conduire toutefois au jugement hâtif de la généralisation que combat toujours la Littérature, dont Philipp Roth nous a très justement appris qu’elle « personnalisait le malheur » humain. Car si la question raciale irrigue l’œuvre faulknérienne, lui donnant une forme d’audace mature, il faut sans doute la considérer comme une toile de fond, celle d’une fresque gigantesque où fourmillent tant de tares, de déraisons, de défaillances humaines, ataviques et sociétales qu’elle ne saurait être un seul et unique sujet d’analyse. Souvent les Noirs, dont le parler si singulier nous est rendu avec le respect dû aux marques de l’oralité, assistent-ils en vérité à la défaillance congénitale des Blancs, au déclassement d’une race qui exerce un magistère venu du fond des âges mais dont tous les protagonistes savent combien il est précaire. C’est là toute la force de Faulkner, qui nous révèles toutes les imperfections des communautés humaines.
Il est tentant d’ouvrit, au risque de ne jamais conclure cette Odyssée en terre confédérée, les portes de l’enfer rural et miséreux de Tandis que j’agonise, où la disparition d’Anse Budren, matriarche aux allures de Reine évaporée, nous conduit dans le sillage de caractères minables et de fautes expiables, où l’exploitation de la pitié côtoie l’impéritie du médecin – le fameux Peabody – et la honte adultérine que tant de familles affrontent. Par le monologue intérieur – encore lui ! – à travers l’adjonction de récits en apparence périphériques, dans ce concert de voix que l’on croit discordantes et qui donnent pourtant du sens à ce qui n’en a pas, c’est-à-dire la lente procession d’un cercueil parti pour Jefferson, éclate avec vigueur la conception du temps propre à Faulkner. A la manière d’un Dunne des mots, héritier du « sérialisme » anglais qui révolutionna les travaux sur la conscience et la nature du temps, le Prix Nobel 1949 a toujours estimé que le Présent, le Passé et l’Avenir coexistaient, reléguant cette tripartition commode au rang d’artifice.
Le férus de Faulkner pourraient enfin se ruer sur L’Invaincu, dont la structure en sept parties peut dérouter – le roman fut d’abord découpé en nouvelles – mais qui rassemble les grands thèmes chers à l’auteur, comme une synthèse involontaire, brillante et nécessaire, la chronique de la création, du mythe par lui-même. On y retrouve mêlés la guerre de Sécession suivie en toile de fond, c’est-à-dire à l’arrière auprès du jeune Bayard – l’infatué Sartoris dans son roman de formation ! – et de son frère Ringo, dont le Sang noir anime l’auteur autant que l’héritage. Mais L’Invaincu plante aussi le décor d’une Amérique – et, au-delà d’elle, d’un pays comme cela interviendra durant les deux Guerres Mondiales – maintenu par la fermeté, l’inexpugnable volonté de la femme. Rosa Millard – dite Granny – assure le maintien, l’ordre quand tout chavire dans le tohu-bohu des balles, des carpetbaggers et la folie du KKK.
Faulkner est donc, malgré ses apparences de reclus du Grand Sud, un écrivain de l’Universel dont la prose dure explore nos failles d’enfants devenus pères, de légataires à leur tour transmetteurs. C’est sans nul doute le romancier Jean Carrière, cantonné à un régionalisme qui étouffa l’aura méritée de son talent, qui m’a ouvert les voies de la conclusion. Pour le Goncourt 1972, qui opposa longtemps Hemingway à Faulkner, « le second est un véritable écrivain, c’est-à-dire l’inventeur d’un pays, d’un Sud imaginaire, de personnages et de drames tandis que le premier ne fait que recopier la réalité, à la manière d’un journaliste ». Tel est le destin des Grands : plonger dans les racines parfois meurtries pour espérer toucher au ciel de la Reconnaissance, non des contemporains, mais des lignées, de la descendance, des races perpétuées par le Temps qui firent, justement, toute l’œuvre de Faulkner.
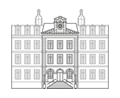
 Romain Artigueberre
Romain Artigueberre


 Sorbonne Université Presses
Sorbonne Université Presses  Pixabay
Pixabay 




 Sorbonne Université Presses
Sorbonne Université Presses
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N'hésitez pas à contribuer !