Né en 1896 à Chicago et mort en 1970 à Baltimore, l’écrivain John Dos Passos est de ces plumes injustement oubliées par la postérité. Père d’une écriture expérimentale, qui souligne avec finesse les travers de l’Homme pressé, la crise de la transcendance et l’horizontalité d’un monde aux promesses toujours déçues, cet amoureux de la Vieille Europe n’a pas eu droit, en 2020, à l’anniversaire posthume qu’il méritait. C’est cet affront que Romain Artiguebère tente modestement de laver, tant l’œuvre de « JDP » se doit d’occuper, aux côtés de Faulkner, Hemingway, Fitzgerald ou Wharton, une place de choix dans le rayon étasunien de nos bibliothèques.
Habité depuis ma prime jeunesse par cet « ange-démon qui pousse à me pencher sur tout ce qui guette déjà le temps avec des yeux d’oubli », je ne me suis jamais lassé des saveurs de l’infime aux relents de pitié. Claironne en moi, comme chez Gary, une étrange attirance pour ce qui trop souvent s’efface devant l’éphémère, la gloriole des succès partiellement mérités. C’est une propension d’homme seul, rétif à ce que Roger Nimier vomissait à raison : « la mode ». Et ce sourd épanchement pour les biens occultés m’a très souvent conduit sur les rives du folklore. Ce furent des recensions cartographiques aux airs d’explorations larbaldiennes, des logorrhées solitaires exposant de dérisoires principautés, quelques soliloques enjolivant l’enclave de Saint-Marin, la splendeur tarie de Nauru et la grandiloquence du souverain George Tupou. Par une coquetterie tirant vers la gourmandise, je me repais toujours des hasards, quitte à les convoquer un peu parfois. Et j’aborde un auteur par le petit bout de sa lorgnette éditoriale, entreprenant des assauts littéraires comme on charge un adversaire. A revers. Préférant les flancs ardus aux voies royales de la distinction, de la préface ou des fats incipit. Je traîne alors en librairies comme un archéologue, un traqueur de trésors oubliés dont la beauté n’éclaire hélas plus rien et qui sommeillent dans l’ombre poussiéreuse des honneurs vulgaires. John Dos Passos a subi beaucoup d’injustices. Il fut mis au rebut par la critique, abandonné de Sartre – qui vit pourtant en lui dès 1938 « le plus grand écrivain de notre temps » – et moqué par Hemingway, dont l’esprit partisan ne supporta pas la pureté justicière de son homologue dans l’affaire José Roblès. C’est d’ailleurs cette expérience malheureuse de la guerre d’Espagne qui fit croître en Dos Passos les germes du doute quant à son engagement à l’extrême gauche de l’échiquier politique.

John Dos Passos reads aloud to Katy Dos Passos(?) aboard the Anita, 1932. Photograph in the Ernest Hemingway Collection at the John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston.
Pour entrer dans son œuvre et la saisir pleinement, il convient d’oublier les stériles comparaisons avec d’autres écrivains américains. Face à Hemingway, par exemple, Dos Passos oppose une confection qui lui est propre, un style particulier, un rythme singulier. Il nous laisse en héritage deux trilogies – USA et Washington DC – où s’entremêlent des biographies historiques renseignant sur l’Amérique ardente, des « collages » d’actualités brutes alliant slogans publicitaires assourdissants, allocutions ou chansons populaires.
Premier témoin de « l’Occident » naissant
John Dos Passos, fils d’un avocat d’origine portugaise, est certes né à Chicago mais son cœur d’enfant illégitime ne cessera de balancer, dans sa vie comme dans son œuvre, entre l’Europe et le Nouveau Monde. C’est sans doute l’île de Madère, dont la géographie elle-même contient le tiraillement qui sépare et rapproche les deux rives de l’Atlantique, qui résume le mieux l’attraction du père de USA pour une Europe où il fut d’abord élève dans un internat anglais puis par la suite ambulancier durant la Première Guerre Mondiale. De la Guerre, il est souvent question dans l’œuvre de l’écrivain. Car celui-ci est le maître du désenchantement, des vies brisées, des rêves de l’Amérique première bafoués par les « nouveaux venus » qui s’enrichissent sur la bête, entravent l’espoir des « grosses galettes » et surtout – thème récurrent s’il en est dans cette œuvre foisonnante – corrompent les valeurs institutionnelles des Pères Fondateurs.
J’ai découvert Dos Passos en confiné, m’immergeant avec lui dans l’Amérique en feu quand nos corps gourds des réclusions forcées fustigeaient l’agonie de notre condition. Ce fut là le paradoxe de cette rencontre : errer dans la ville que nous ne voyions plus, râper l’asphalte frais depuis nos quotidiens murés, sauter de tram en train pour mieux saisir les épopées des damnés du bitume.
Dos Passos est d’abord un chroniqueur, un écrivain de l’Histoire dont les personnages sont surtout des miroirs. Cette Histoire est celle d’une Amérique en mutation, contrariée par les soubresauts d’un monde encore européen et qui, comme l’écrira Paul Morand à l’issue de la Première Guerre Mondiale, changera finalement de centre pour laisser les Etats-Unis « rafler la mise ».
Mais Dos Passos, dont – pour les esprits grincheux de la critique facile – la modernité passe comme les beautés, nous offre avant tout des procédés dynamiques, un enchevêtrement de techniques visuelles et olfactives absolument extraordinaires. C’est un cinéma écrit qu’il déploie, une fresque américaine dont « l’œil caméra », chapelet de descriptions sensorielles incrustées dans la trame narrative, casse la facilité d’un mouvement qui broie. On est bien loin du rouleau de Kerouac ou des lignées faulknériennes sises à Yaknapatawpha. Avec Dos Passos, l’Atlantique est certes une passerelle et le trottoir océan mais le roman se subdivise toujours comme les paperolles de La Recherche ou des collages de prime jeunesse.
La prose de Dos Passos vit comme le flux, le caprice d’une marée littéraire où surgissent des baïnes et des vagues légendaires. Sa propre fille révéla d’ailleurs l’entreprise réussie de son père : que les « mots vivent sur la page » et, surtout, « qu’ils en sortent, se dressent, sautent à la figure puis explosent comme des bombes ». De cette explosion lettreuse nous ne sortons pas blessés, mais au contraire grandis.
USA, Cathédrale de verre, de bitume… et de papier
Ce qui frappe en refermant la trilogie qui lui valut sa renommée, c’est l’incapacité que l’on éprouve à décrire un personnage autre que la ville. C’est bien là tout le génie de cet auteur : écrire sur la vitesse qui happe, le mouvement qui noie, les organisations – Partis comme Syndicats – qui, loin de révéler l’homme à lui-même, l’étouffent et le corrompent. Dos Passos est donc un écrivain des espérances déçues, des ardeurs déjà chues dans un pays marqué par le triomphe de l’injustice et l’étiolement des libertés depuis l’affaire Sacco et Vanzetti.
L’enfant de Chicago est aussi, nous l’avons esquissé, un créateur protéiforme.
Comme Sterne avec Tristram Shandy, dont l’ordonnancement, la technique narrative et les pages marbrées eurent des airs de révolution romanesque, John Dos Passos ponctue souvent le fil de ses fictions d’entrefilets variés qui cassent la narration mais rythment aussi l’action et enrichissent le message d’un auteur-prophète, annonciateur d’une société de l’image et du son, pervertie par le bruit, la mise en scène de soi, la croyance nouvelle de l’Homme sans transcendance, dont la Trinité ne tient plus que dans le Mot, la Promesse et l’Avidité.
Dos Passos par-delà USA
On aurait tort de faire de Dos Passos le père d’une seule trilogie. Même à Paris, où je me plais souvent à évaluer le cours d’une Plume par des odyssées de librairies, ses romans mineurs sont souvent réservés à la commande et n’attirent pas beaucoup les chalands oublieux. Si USA domine, beaucoup d’autres chefs d’œuvre ont pourtant vocation à sortir de l’anonymat. Certains, comme Numéro Un ou Milieu de Siècle, parce qu’ils savent capter les tares d’un temps qui ne sont pas étrangères à celles du nôtre. C’est par exemple le cynisme exaspérant du candidat Crawford, un de ces meneurs d’hommes capables d’affirmer, « pour qui devient une personnalité politique connue », qu’il est « rudement utile d’avoir une vieille mère présentable », mais aussi le servage volontaire et l’abaissement moral de son conseiller Tyler Spotswood, lequel révèle sans doute le dégoût de l’auteur pour une engeance politicienne déjà vilipendée dans d’autres œuvres, où transparaissent notamment la corruption des syndicats et une certaine déception vis-à-vis du New Deal de Roosevelt. Numéro Un, que je conseille ardemment à l’heure où le Politique renaît en France, est aussi la chronique d’un abaissement moral, d’une oxydation des idées au profit du pouvoir et de la longévité.
Nous devons enfin à Dos Passos des œuvres expérimentales qui, comme des ballons d’essai réussis, donnent à lire la crise de l’Homme et l’absurdité de la quête dans ce qu’il nomme lui-même une « nation vaincue ». Dans Les Rues de la Nuit, dont nous célébrerons l’année prochaine le centenaire de la publication, l’errance nyctalope de Fanshaw et Wenny ont des airs de cauchemars éveillés. La médiocrité ambiante assassine le destin des personnages et sape la finesse de ce trio aspirant bien plus que ce qu’un continent matérialiste est à même de fournir à sa nouvelle génération. Le Nouveau Monde est l’assassin du style, de l’esthétisme et de l’ancien, c’est-à-dire d’une Humanité qui ne résonne plus dans le chaudron de l’Amérique ardente. Et le débat permanent qui lie Fan, Wenny et Nancibell, marcheurs invétérés fuyant l’échec et rencontrant partout ce qui génère pourtant leur marche, leur permet d’établir une conclusion : l’Homme nouveau n’est plus porté à la profondeur. Quand Wenny regrette que la Raison ne soit qu’une « illusion », les Hommes réfléchissant « trop souvent aux choses après qu’elles se soient produites », Fanshaw pense – en réalité dans le même esprit – que « la différence entre nous et des gens comme Pic de La Mirandole ou Pétrarque » tient précisément dans le fait qu’ils « pouvaient mettre leur Raison dans la pensée, dans l’art et la libération du monde » quand leur génération la « gaspille dans des complications absurdes ».
Dos Passos est donc le Messager du monde contemporain, celui qui broie l’individu, donne à croire sans remplir sa promesse, celui qui enserre jusqu’à l’injustice, le désespoir et la malchance, qui rend la vie répétitive, creuse et matérielle. Ville, Syndicat, Parti, Usine ou Université sont les théâtres de possibilités sans cesse entravées. L’Amérique pionnière semble avoir cédé sous la cupidité. Dos Passos, sans doute un peu désabusé, nous la présente comme une chance devenue prédation, un espace où l’émancipation se mue en désespoir, en agonie des ambitions. Comme le dit Wenny, dans l’une de ses discussions nocturnes avec Nancibell, « vivre est terriblement dangereux ». En Amérique surtout et en Europe aussi.
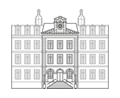
 https://commons.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/


 Gallimard
Gallimard 




 Fabienne Marié Ligier
Fabienne Marié Ligier
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N'hésitez pas à contribuer !